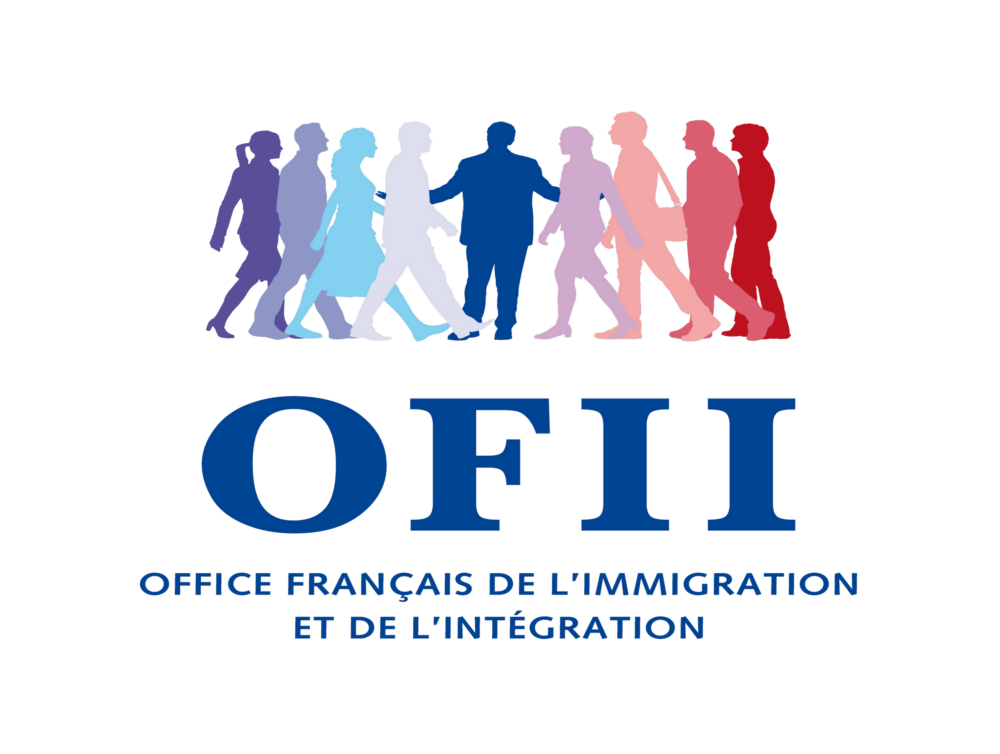Nouvelle victoire face à la CGSS de la Guyane
Dans une décision rendue le 11 février 2025, le Tribunal Judiciaire de Cayenne – Pôle Social a enjoint la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane à délivrer une attestation de vigilance à notre cliente (TJ Cayenne, 11 février 2025, n° RG 24/00302). Cette décision prouve aux entreprises locales qu’il est possible de surmonter les difficultés administratives impactant leur activité économique.
📌 Un enjeu stratégique pour les entreprises guyanaises
L’attestation de vigilance, prévue par l’article L.243-15 du Code de la Sécurité sociale, est un document essentiel pour toute entreprise souhaitant contracter avec des donneurs d’ordre publics ou privés. Dans cette affaire, la CGSS de la Guyane avait refusé de la délivrer à notre cliente. Ce refus était d’autant plus problématique que l’entreprise dépendait de ses contrats avec des partenaires stratégiques.
Grâce à l’intervention de notre cabinet d’avocats, la justice a reconnu l’urgence de la situation et a ordonné la délivrance immédiate de l’attestation sous astreinte. Cette décision souligne l’importance d’une défense juridique efficace pour les entreprises confrontées à des blocages administratifs.
⚖️ Une décision clé du Tribunal Judiciaire de Cayenne
Le Tribunal a estimé que :
L’absence de l’attestation de vigilance compromettait directement la survie de notre vliente, un tiers de son chiffre d’affaires étant en jeu.
En l’absence d’un titre exécutoire justifiant le non-paiement des cotisations, la CGSS ne pouvait refuser la délivrance de l’attestation.
Par conséquent, une astreinte de 100 euros par jour de retard a été mise en place pour garantir l’exécution rapide de la décision.
Notre cabinet a démontré avec succès que la situation justifiait une procédure en référé, permettant une réponse judiciaire rapide et adaptée aux impératifs économiques de l’entreprise.
🏛️ Faire valoir ses droits en Guyane : un accompagnement juridique sur-mesure
Notre cabinet d’avocats est spécialisé dans l’accompagnement des entreprises en contentieux URSSAF et sécurité sociale.
Vous êtes une entreprise en Guyane confrontée à une problématique juridique ? Besoin d’une assistance en droit social ou en contentieux URSSAF ? Contactez notre cabinet dès aujourd’hui pour une expertise adaptée à votre situation.
Nicolas Taquet
Avocat au barreau de Pau
Liens externes :